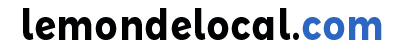Communales et municipales 2020 : Le rôle prépondérance des partis politiques dans la gestion des communes de la 4ème mandature
Tenues dans un contexte particulier, avec un code électoral porteur de grandes innovations parfois mal comprises par les acteurs et controversées, les communales et municipales de 2020 continuent de susciter des débats avec l’intervention du législateur en plein processus d’élection des exécutifs communaux et municipaux juste pour annoncer clairement la tutelle politique des partis politiques sur la commune.
Le rôle prépondérant des partis politiques.
Alors que le code électoral du 15 novembre 2019 prévoyait la présentation de la liste de candidatures aux postes de maires et adjoints, la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, à travers trois dispositions, a positionné les partis politiques au cœur de la gestion des communes du pays, envers et contre deux principes essentiels, la libre administration des collectivités territoriales et les responsabilités du maire devant le conseil communal ou municipal.
Retour sur les principes de libre administration et de responsabilité du maire devant le conseil communal et municipal.
La libre administration des collectivités territoriales est un principe qui permet de garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités territoriales peuvent agir. Elle est souvent invoquée à l’encontre de lois soupçonnées de ne pas la respecter. En France, le Conseil constitutionnel classe ce principe parmi les droits et libertés invocables mais ne sanctionne que les « atteintes excessives du législateur » (pour des exemples de validation : déc. n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales instituant le conseiller territorial, et déc. n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). La responsabilité du maire devant le conseil communal est un principe qui permet au dernier d’élire, de contrôler et de pouvoir démettre le premier. Or, suivant les dispositions actuelles du code électoral, en cas de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le ou les parti(s) politique(s) concernés désignent le maire, ses adjoints et les chefs d’arrondissement sans aucune ratification du conseil communal. Il en découle que le conseil n’a pas ratifié, encore moins entériné la désignation de l’organe exécutif.
Les pouvoirs exorbitants des partis politiques dans la gestion communale dans la désignation des exécutifs communaux et municipaux.
Selon les dispositions de l’article 189 nouveau de la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral les partis politiques désignent le maire, ses adjoints et les Chefs d’arrondissement dans deux cas de figure :
- Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.
- A défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle.
Le cumule de ces deux dispositions a fonctionné dans les 77 communes. En dehors des élections obtenues avant la loi 2020-13, tous les exécutifs communaux et municipaux ont été désignés soit par le parti ayant obtenu la majorité absolue des sièges au conseil, soit par les partis UP et BR dans le cadre d’un accord de gouvernance communale. En prenant en compte la loi 2020-13 et les résultats des communales et municipales, on peut, sans risque de se tromper affirmer que les 77 exécutifs communaux et municipaux auraient pu être désignés par UP, BR et FCBE dans le cadre de la majorité absolue sortie des urnes et par UP et BR dans le cadre d’un accord de gouvernance. Du coup, les 77 exécutifs communaux et municipaux sont désignés par les différentes formations politiques, avec des conséquences inévitables :
- des erreurs matérielles à corriger et donc changement de chefs d’arrondissement juste après les installations, les prises de fonction et les célébrations de désignation par endroit ;
- des conseillers qui boycottent la séance de désignation et protestent publiquement contre le choix des partis politiques ;
- des potentats locaux qui dénoncent certains choix des partis politiquent…
L’implication des partis politiques dans la destitution des maires, adjoints au maire et chefs d’arrondissement.
C’est l’article 195 nouveau qui prévoit l’implication des partis politiques dans la destitution des exécutifs communaux en y incluant les chefs d’arrondissement qui bénéficiaient jusqu’alors d’un flou juridique en la matière : En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers, si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale. L’autorité de tutelle, par arrêté, constate la destitution.
Le rôle vertueux attendus des partis politiques
Il est clair que les partis politiques peuvent renforcer la décentralisation, mais uniquement dans le cadre d’une implication vertueuse. En veillant aux respects des engagements électoraux pris par les candidats devenus conseillers majoritaires, maires, adjoints au maire et chefs d’arrondissement. Ainsi, ils doivent faire transparaître l’idéologie de la formation politique dans les choix de politiques locales et la promotion des valeurs éthiques, morales et républicaines. Les partis politiques peuvent s’avérer décisifs dans le plaidoyer pour le transfert des compétences et des ressources de l’Etat vers les collectivités locales. Ainsi, le plaidoyer de la société civile et des personnalités publiques se trouvent renforcer par la classe politique. Un tel plaidoyer peut être efficace s’il est sincèrement porté par les partis politiques soutenant les actions du gouvernement. Les partis politiques peuvent également contribuer à faire évoluer le cadre législatif et règlementaire de la décentralisation. C’est le cas notamment du BR et de l’UP qui contrôlent le parlement et disposent d’une écoute favorable de la part du chef de l’Etat. De plus, ils doivent travailler à la culture de la décentralisation et de la discipline partisane au sein des militants mais surtout au sein des conseillers communaux et municipaux pour une grande cohésion en leur sein, source de stabilité. Les partis politiques doivent éviter de prendre le maire en otage et de lui demander des commissions pour son positionnement. Une telle commission peut prendre plusieurs formes. En revanche, il est normal d’instituer des cotisations transparentes à tous les élus et cadres nommés, au même titre que les simples militants. Ainsi, la loi aurait eu raison de donner tant de pouvoir aux formations politiques dans une perspectives transitoire.
FSK