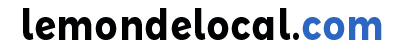Partenariat ADECOB et la Coopération suisse : Un atelier permettant aux communes d’aborder un tournant décisif dans la gouvernance locale
Dans un contexte de réforme profonde de la décentralisation au Bénin, les communes du Borgou se retrouvent à la croisée des chemins. Réunies à Komiguéa pour un atelier de co-construction et de partage d’expériences, les administrations communales du Borgou, sous l’impulsion de l’ADECOB (Association pour le Développement des Communes du Borgou), ont entamé une réflexion stratégique sur la gouvernance locale performante à travers le thème « Construire ensemble les solutions ».
Par la rédaction :
Une décentralisation en mutation
Depuis la promulgation du Code de l’Administration Territoriale (loi n°2021-14 du 20 décembre 2021), le paysage institutionnel local a été profondément modifié. L’une des principales réformes réside dans la séparation nette entre fonctions politiques (incarnées par le maire et les élus) et fonctions administratives et techniques (confiées au Secrétaire Exécutif – SE). Si cette transformation vise une professionnalisation accrue de la gestion communale, elle soulève de nouveaux défis, notamment en matière de coordination, de partage du pouvoir et de consommation des crédits disponibles.
Le duo Maire-SE : entre complémentarité et tensions
La réforme a fait du secrétaire exécutif (SE) le véritable chef d’orchestre administratif des communes. Son rôle ne se limite pas à la coordination du secrétariat exécutif, mais à une responsabilité première dans tous les compartiments de la gestion administrative et technique de la commune. Responsable de la mise en œuvre du budget et des marchés publics dont il est l’autorité approbatrice, le SE est aussi et surtout le responsable des politiques publiques et de la gestion des services municipaux et concentre désormais l’essentiel des leviers de l’action publique communale. Le maire, quant à lui, reste la « première autorité politico-administrative » et préside les organes de délibération, mais son champ d’action exécutive s’est réduit à la police administrative, à la protection civile et à la diplomatie municipale. Même les services de communication lui échappent en grande partie. Dans ce contexte, dans cette nouvelle configuration une nouvelle forme de collaboration intelligente entre les élus et les techniciens s’impose. Pour Franck S. KINNINVO, expert en communication et gouvernance locale, « la réussite de la réforme dépend de la capacité à instaurer un leadership collaboratif fondé sur la confiance, la communication interne et externe, la reconnaissance mutuelle et la transparence ». Le SE doit développer des aptitudes de collaboration, dans le champ de la licéité pour faciliter au maire l’exercice de sa responsabilité de « première autorité politico-administrative ». Autrement, cette disposition du code restera une coquille vide.
Leadership collaboratif : clé de voûte de la performance communale
Le concept de leadership collaboratif est au cœur des nouvelles dynamiques proposées. Il repose sur l’engagement collectif, le partage des responsabilités, la communication et l’ouverture à l’innovation. Dans les administrations locales, cela signifie impliquer activement les équipes techniques, les élus, les citoyens et les partenaires extérieurs dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. À travers des outils tels que le Plan de Développement Communal (PDC), le Plan Annuel d’Investissement (PAI) ou encore le Budget Participatif, certaines communes comme Ségbana et Pèrèrè ont commencé à expérimenter une gouvernance inclusive et transparente. Cette approche favorise l’émergence de décisions mieux éclairées, d’initiatives locales fortes et d’un climat de confiance renouvelé. « Le SE ne peut pas tout faire seul », martèle M. KINNINVO. Il faut créer des cadres de dialogue structurés, faire confiance à son équipe, déléguer, écouter, reconnaître les contributions. L’utilisation d’outils numériques comme Trello, Slack ou Google Workspace est encouragée pour fluidifier le travail d’équipe et documenter les décisions. Au Bénin, s’indigne le Consultant, nous ne savons pas nous faire confiance. Or, leadership collaboratif exige la confiance mutuelle. Les SE n’aiment pas toujours travailler avec les cadres déjà présents avant leur arrivée et le clou du manque de confiance est la difficile collaboration entre les SE et les cadres qu’ils ont eux-mêmes tiré au sort.
De la planification à l’action : une exigence de qualité
La réussite de cette réforme repose aussi sur la qualité des documents de planification. Le PDC, en particulier, doit incarner une vision stratégique alignée sur les priorités nationales tout en répondant aux spécificités locales. Un modèle économique doit être développé dans le PDC afin d’assurer la promotion de l’économie locale. L’intégration du genre, de la dimension environnementale, de la promotion de l’économie locale et de l’intercommunalité y sont désormais des impératifs. L’expert Franck S. KINNINVO invite les communes à sortir des PDC kilométriques pour s’inspirer de la concision et de la précision du PAG 1 et 2, avec une théorie de changement concise et précise qui doit guider les politiques publiques de la commune. Mais planifier ne suffit pas : encore faut-il exécuter. Et c’est là qu’intervient la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse via le PTA, adossée à des mécanismes de reddition de comptes, de participation citoyenne et d’évaluation. La « gestion participative axée sur les résultats de développement (GPAORD) » et les démarches de communication pour le développement (ComDev) viennent renforcer cette dynamique. L’atelier a permis d’examiner plusieurs outils d’analyse stratégique. Le modèle VICA (Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté), utilisé pour décoder les dynamiques sociales et sécuritaires, a été croisé avec les approches PESTEL-S (Politique, Économie, Socioculturel, Technologie, Écologie, Légal – Sécurité). Ces modèles ont permis d’affiner le diagnostic territorial et de proposer des réponses adaptées.
Des tableaux de bord de performance ont été présentés, mettant l’accent sur la reddition de comptes, les objectifs de travail clairs, la qualité de vie au travail, et la mobilisation collective. Le personnel communal, les conseils de supervision et les services déconcentrés de l’État sont appelés à jouer un rôle plus actif et mieux coordonné.
Une administration locale modernisée : entre défis et espoirs
Malgré les avancées notables, de nombreux défis persistent : faible consommation des crédits, résistances institutionnelles, insuffisance de ressources humaines qualifiées, cloisonnement des services… La conférence de Komiguéa a donc mis en lumière la nécessité d’une coordination interservices accrue. La possibilité d’utiliser les outils numériques et de permettre aux maires de prendre part aux CoDir hebdomadaires. Mais la coordination interservices, c’est aussi dans les arrondissements et avec les services déconcentrés de l’Etat qui accompagnent la commune avec les ressources nationales disponibles. Ces ressources sont humaines, informationnelles et financières et s’inscrivent dans le second volet de la tutelle, l’assistance-conseil et l’accompagnement. C’est pourquoi, l’expert propose une activation et une réorientation de la des conférences administratives communales pour une meilleure articulation entre les acteurs de terrain (mairie, services déconcentrés, OSC, PTF…).
Ce que l’atelier de l’ADECOB démontre avec force, c’est que l’avenir des communes ne se jouera ni dans l’isolement des techniciens ni dans la seule posture politique des élus. Il se construira dans le dialogue, la coopération et l’intelligence collective. La réforme offre un cadre. Aux acteurs locaux de l’habiter avec ambition, compétence et engagement.