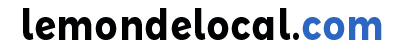Faible consommation des ressources financières dans les communes : Nécessité de parachever la réforme de l’administration locale
Au premier semestre 2024, les communes du Bénin n’ont consommé que 6,44 milliards de francs CFA sur un budget d’investissement annuel prévisionnel de 163,12 milliards FCFA, soit à peine 3,79 % des prévisions budgétaires. Ce phénomène, observé pour la troisième année consécutive, soulève de nombreuses questions sur les défis des administrations communales issues de la réforme de 2021. Face à cette situation, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer un dispositif de gestion budgétaire trop rigide et un cadre réglementaire qui, au lieu de favoriser une utilisation efficace des ressources, semble plutôt la ralentir.
Des budgets sous-consommés alors que les besoins sont criants
Les données publiées par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) mettent en lumière une grosse difficulté des communes à exécuter leur budget d’investissement. Pourtant, ces budgets sont censés répondre à des besoins urgents en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures et de développement économique local. À titre d’exemple, les communes ordinaires ont réalisé seulement 6,3 % de leurs dépenses d’investissement en 2024, tandis que les communes à statut intermédiaire ont atteint un maigre 2,59 % et celles à statut particulier moins de 1 %. Le paradoxe est saisissant : alors que 84 milliards FCFA de ressources budgétaires ont été reportées au début de l’année 2024, les dépenses d’investissements, eux, ne suivent pas. « Nous avons les fonds, mais nous ne pouvons pas les utiliser à cause de la lourdeur des procédures de passation des marchés publics. » rapporte le Secrétaire Exécutif d’une commune qui lui est resté peu bavard.
Les lourdeurs administratives pointées du doigt
D’abord, un contrôle financier qui ralentit tout. La réforme de la décentralisation a introduit un contrôle financier systématique des dépenses dans toutes les communes. Désormais, aucune dépense ne peut être engagée sans validation préalable du délégué du contrôleur financier. Or, ces agents sont en nombre insuffisant : un seul contrôleur peut gérer jusqu’à trois communes, retardant ainsi les prises de décision. « Avant de dépenser un seul franc, il faut obtenir le visa du contrôleur financier, qui est souvent absent ou surchargé. Pendant ce temps, nos projets sont à l’arrêt » explique un autre SE d’une commune du Nord. Avec les plaintes des acteurs communaux, le Ministère en charge des Finances a déployé davantage de délégués du contrôleur financier (DCF) dans les communes. Selon un Secrétaire Exécutif, « malgré le nombre accru de DCF, les va-et-vient des parapheurs entre l’administration communale, notamment les SE, les PRMP et les DAAF d’une part et les DCF d’autre part peuvent durer une année budgétaire sur un même dossier. A cela s’ajoute les va-et-vient des parapheurs entre l’administration communale et les trésoriers communaux ». Tous ces va-et-vient, au bout du rouleau, n’est imputé qu’à l’administration communale en guise de contre-performance. Il devient important de revoir ce modus operandi dans les communes.
Ensuite, les SE dénoncent une passation des marchés publics interminable : « Nous passons des semaines à corriger les observations des autorités de contrôle, et une fois le dossier transmis au niveau national, on nous impose encore des modifications. C’est un processus interminable ! ».
Les délais de passation des marchés sont un autre frein majeur. Ces cadres techniques évoquent des mois d’attente avant la validation de leurs plans de passation des marchés, ce qui empêche le démarrage à bonne date des projets et des réalisations. Une fois le plan de passation des marchés publics validé, il faut ouvrir les procédures qui peuvent s’étaler sur deux ans. A ce niveau encore, les DCF sont pointés du doigt. Des corrections qui se multiplient à chaque aller-retour de parapheur, sans oublier les remises en cause… Dans ce processus de passation de marchés publics, il faut aussi s’attendre à des reprises pour procédure infructueuses. Les entreprises ne se bousculent pas pour soumissionner tant la paperasse est importante, sans garantie d’accès au précieux contrat. Les longs délais de paiement des factures des entreprises, imputables au service financier des communes, au DCF et au Trésorier Communal font que beaucoup de PME calculent longuement avant de s’engager dans les marchés publics communaux.
Des fonds qui existent mais qui ne sont pas mobilisables
Un autre problème majeur réside dans le décalage entre l’inscription budgétaire et la mise à disposition réelle des fonds. Plusieurs communes se plaignent d’avoir des Bordereaux de Transfert de Ressources (BTR) non suivis de liquidités. « En 2024, nous avons reçu des notifications budgétaires, mais jusqu’à aujourd’hui, aucun versement n’a été effectué. Comment voulez-vous que nous travaillions dans ces conditions ? » Un exemple frappant est celui du FADeC investissement 2024 : au 30 juin, aucune commune n’avait encore reçu un seul franc de ces fonds destinés à des projets structurants.
Le projet COSO, un frein à la consommation des budgets ?
Outre les lourdeurs administratives, un autre élément est pointé du doigt : le projet COSO (Cohésion Sociale et Opportunités Économiques), financé par la Banque mondiale et mis en œuvre via les communes. Ce projet repose sur un modèle inédit où l’exécution des fonds est confiée directement aux communautés locales. Problème : ces communautés, souvent dépourvues d’expertise en gestion budgétaire et en passation de marchés, peinent à utiliser ces ressources de manière efficace. Résultat : des dizaines de milliards restent bloqués, augmentant artificiellement les reports de crédits d’une année à l’autre. « On nous oblige à transférer les fonds aux communautés, mais elles ne savent pas les utiliser. Comment voulez-vous que les budgets soient consommés dans ces conditions ? » questionne un SE. Ce mécanisme de gestion suscite de plus en plus de critiques et appelle à une révision des modalités d’exécution des projets financés par COSO.
Des recommandations pour sortir de l’impasse
Face à cette situation préoccupante, plusieurs experts en gouvernance locale proposent des pistes d’amélioration : Réduire les délais de contrôle financier en augmentant le nombre d’agents affectés aux communes ; accélérer la validation des plans de passation des marchés en instaurant un système de suivi plus efficace ; libérer les fonds plus tôt dans l’année pour éviter les reports budgétaires massifs ; revoir le modèle du projet COSO afin de donner aux communes une marge de manœuvre plus importante ; former davantage les acteurs communaux aux procédures de gestion financière et de passation des marchés.
Pour Hamed TABE GBIAN, l’ingénieur Génie Civil et Spécialiste en Marché Public et PPP / Chargé de Programme Maitrise d’Ouvrage à ADECOB, il n’y a pas de pression sur les acteurs de la chaine. Vu la sensibilité de la dépense publique, les acteurs prennent plutôt toutes les garanties nécessaires à chaque étape : planification, passation, contrôle, exécution et liquidation etc … Pour améliorer les dépenses d’investissement, Hamed TABE GBIAN fait plusieurs propositions notamment mettre les ressources à la disposition de la commune dans les délais impartis ; doter les services communaux en personnel qualifié et en nombre suffisant ; renforcer les capacités des communes en matière de gestion financière ; mettre à la disposition de l’ensemble des personnes ou structures en relations fonctionnelles avec le Contrôle Financier, un outil de référence pédagogique et opérationnel pour la conduite des opérations qu’elles initient et enfin renforcer le contrôle interne adéquat, orienté vers l’allègement du contrôle a priori de l’exécution des dépenses publiques.
Selon Hassan TENAKAH, socio-économiste et Expert en évaluation des politiques publiques, la décentralisation amorcée depuis 2002 avec le contexte dans lequel elle a évolué, marquée par des imperfections enregistrées au fil des années de mise en œuvre, justifie par elle-même la nécessité d’une réforme. Ainsi nul ne devrait douter de la pertinence d’une telle réforme surtout dans sa logique de rendre plus performante l’administration communale. La réforme, selon lui, relève plusieurs aspects positifs, comme notamment la consécration du couloir technique chapoté par le Secrétariat Exécutif, qui devrait impulser une dynamique sur les performances techniques, économique et financières dans un parfait maillage avec le politique. Evidemment une telle ambition ne saurait s’appliquer sans heurts et c’est dans ce registre que s’inscrit ce sujet. Comme toute œuvre humaine, la réforme est perfectible. Mais de là à lui attribuer tout seul la faute ne serait pas juste. En une phrase, la réforme a du bon, mais elle doit être ajustée pour ne pas étouffer l’action communale. L’objectif reste le développement local, et non la bureaucratisation excessive.
Par Irédé David R. KABA